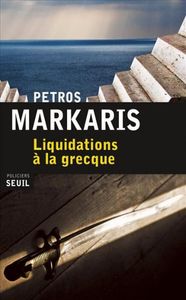Je
n’ai pas peur de vous !
(Maria Alekhina, Pussy Riot)
Voici le texte écrit par Maria Alekhina une des Pussy Riot, lu à son procès par son avocate. Avec Nadejda Tolokonnikova et Ekaterina Samoutsevitch, elle a été condamnée à deux ans de prison.
Les Inrockuptibles, solidaires des Pussy Riot.
Ce procès est exemplaire. Le pouvoir en rougira, et pas qu’une
fois, et il en aura honte. Chacune de ses étapes est la quintessence
de l’arbitraire. Comment notre démarche, à l’origine une action
modeste et plutôt farfelue, s’est-elle muée en cet immense
malheur ? Il est évident que, dans une société saine, ce serait
impossible. La Russie, en tant qu’Etat, apparaît depuis longtemps
comme un organisme rongé par la maladie. Et cet organisme réagit de
manière maladive dès qu’on effleure l’un de ses abcès
purulents. D’abord il passe longuement cette maladie sous silence.
Ensuite, il trouve une solution en dialoguant. Et voici ce qu’il
appelle un dialogue. Ce tribunal n’est pas simplement une mascarade
grotesque et cruelle, il est le « visage » du dialogue tel qu’il
se pratique dans notre pays. Au niveau social, pour aborder un
problème par le dialogue, il faut une situation – une motivation.
Ce qui est intéressant, c’est que notre situation a été, dès
l’origine, dépersonnalisée.
Parce que, lorsque nous parlons de Poutine, ce n’est pas
Vladimir Vladimirovitch Poutine que nous avons en vue ; c’est
Poutine en tant que système créé par lui-même, cette verticale du
pouvoir où pratiquement toute la gestion s’effectue à la main.
Et cette verticale ne prend pas en compte, ne prend absolument pas
en compte, l’opinion des masses. Et, c’est ce qui m’inquiète
le plus, l’opinion des jeunes générations. Et cela dans tous les
domaines.
Dans ce dernier mot, je veux dire ma propre expérience, ma propre
confrontation avec ce système. L’éducation, là où commence la
formation de la personne sociale, ignore ce qui constitue cette
personne. Mépris de l’individu, mépris de l’éducation
culturelle, philosophique, mépris des connaissances élémentaires
qui font une société civile. Officiellement, toutes ces matières
sont au programme. Mais elles sont enseignées sur le modèle
soviétique. Résultat : la marginalisation de la culture dans
l’esprit de chaque individu, la marginalisation de la réflexion
philosophique, et le sexisme érigé en stéréotype. L’homme-citoyen
est un idéal balancé au fond du placard.

Toutes les institutions en charge aujourd’hui de l’éducation
s’efforcent avant tout d’inculquer aux enfants les principes
d’une existence automatique. Sans tenir compte de leur âge et des
questions propres à cet âge. Elles inoculent la cruauté et le
rejet de toute idée non conformiste. Dès l’enfance, l’homme
doit oublier sa liberté.
J’ai une certaine expérience de l’hôpital de jour
psychiatrique pour les mineurs. Je peux affirmer que tout adolescent
qui, de manière plus ou moins active, fait preuve d’anticonformisme
peut être aussitôt interné. Dans ces établissements échouent
nombre d’enfants qui viennent d’orphelinats. Oui, dans notre
pays, il est normal de placer en hôpital psychiatrique un enfant qui
a voulu fuir l’orphelinat. Et de lui administrer des
tranquillisants comme l’aminazine, qui était utilisée dans les
années 70 pour mater les dissidents soviétiques.
Dans ces établissements, c’est la répression qui est
privilégiée et non l’accompagnement psychologique. Le système
est basé exclusivement sur la peur et sur la soumission
inconditionnelle. Ces enfants deviennent inévitablement des enfants
cruels. Beaucoup d’entre eux sont illettrés. Et personne ne fait
quoi que ce soit pour y remédier. Bien au contraire. Tout est fait
pour briser, tout est fait pour étouffer la moindre aspiration, le
moindre désir de progresser. Ici, l’être humain doit se fermer et
perdre toute confiance dans le monde.
Voilà ce que je veux dire : une telle conception de l’homme
interdit la prise de conscience des libertés individuelles, y
compris religieuses, et cela touche toute la population. La
conséquence de ce processus, c’est la résignation ontologique,
c’est-à-dire la résignation ontique socialisée. Ce passage, ou
plutôt cette fracture, est remarquable en ceci que, si on l’examine
dans un contexte chrétien, on s’aperçoit que les significations
et les symboles se substituent en significations et en symboles
exactement inverses. Ainsi, aujourd’hui, la résignation, qui est
l’une des catégories essentielles du christianisme, est entendue
ontologiquement non plus comme moyen de purifier, d’affermir et de
conduire à la libération définitive de l’homme mais, au
contraire, comme moyen de l’asservir. On peut dire, en citant
Nikolai Berdiaiev : « L’ontologie de la résignation — c’est
l’ontologie des esclaves de Dieu, non des enfants de Dieu. »

En ce qui me concerne, c’est quand je me suis lancée dans la
lutte écologique pour la forêt de Krasnodar que j’ai pris
conscience de la liberté intérieure comme fondement de l’action.
Ainsi que de l’importance, et l’importance immédiate de l’action
en tant que telle.
Je ne cesse de m’étonner que dans notre pays il faille
rassembler plusieurs milliers de personnes pour faire cesser
l’arbitraire d’un ou d’une poignée de fonctionnaires.
La réaction de milliers de gens de par le monde à ce procès est
en est la preuve éclatante. Nous sommes toutes trois innocentes.
Nous sommes innocentes, le monde entier le dit. Le monde entier le
dit pendant les concerts, le monde entier le dit sur Internet, le
monde entier le dit dans la presse et dans les parlements.
Les premiers mots que le Premier ministre britannique a adressé à
notre président n’ont pas concerné les Jeux olympiques mais il
lui a demandé : « Pourquoi trois jeunes femmes innocentes
sont-elles en prison ? C’est une honte. »
Mais ce qui m’étonne davantage encore, c’est que les gens ne
croient pas qu’ils puissent influencer le pouvoir de quelque
manière que ce soit. Alors que nous organisions piquets et meetings
pour défendre la forêt de Krasnodar, alors justement que je
récoltais les signatures pour les pétitions, beaucoup de gens me
demandaient, et avec un étonnement tout à fait sincère, qui ça
pouvait intéresser… Oui, peut-être, d’accord, c’était la
dernière forêt séculaire de Russie, mais qu’est-ce que ça
pouvait bien leur faire, cette forêt dans la région de Krasnodar ?
Ce bout de terre paumé. C’est vrai, qu’est-ce que ça pouvait
leur faire que la femme de notre Premier ministre Dmitri Medvedev ait
l’intention d’y faire construire une résidence ? Et de détruire
l’unique réserve de genévriers de Russie ?
Voici comment réagissent les gens… Voici encore une preuve que
les gens dans notre pays ont cessé de considérer que le territoire
appartenait à ses citoyens. Ils ont cessé de se considérer comme
des citoyens. Ils se considèrent tout simplement comme des masses
automatisées. Ils ne comprennent pas qu’une forêt leur appartient
même si elle ne se trouve pas à proximité immédiate de leur
domicile. J’en viens même à douter qu’ils aient conscience que
leur propre maison leur appartient. Si une excavatrice s’approche
de l’entrée de leur immeuble, que l’on demande aux gens
d’évacuer les lieux et qu’on leur dise : « Excusez-nous, nous
allons démolir votre maison pour y construire la résidence d’un
fonctionnaire », ils ramassent leurs affaires, leurs sacs et ils
quittent leur maison. Et ils resteront là, dans la rue, en attendant
tranquillement que le pouvoir leur dise ce qu’il faut faire. Ils
sont absolument amorphes, c’est très triste.
Après plus de six mois passés dans une cellule, j’ai compris
que la prison, c’était la Russie en miniature. C’est la même
verticale du pouvoir, où le règlement du moindre problème passe
par la décision exclusive et directe du chef.

En l’absence d’une répartition horizontale des fonctions et
des attributions qui faciliterait considérablement la vie de chacun.
En l’absence également de toute initiative individuelle. Ici,
c’est le règne de la délation. De la suspicion mutuelle. En
prison, de la même façon que dans le reste du pays, tout est basé
sur la dépersonnalisation et sur l’assimilation de l’individu à
sa fonction. Qu’il s’agisse d’un employé ou d’un détenu. Le
règlement sévère de la prison, auquel on s’habitue rapidement,
ressemble au règlement de la vie qu’on impose à chacun dès sa
naissance. Dans le cadre de ce règlement, les gens commencent à
s’attacher aux choses insignifiantes. En prison, c’est par
exemple une nappe ou de la vaisselle en plastique qu’on ne peut se
procurer qu’avec la permission du chef. Dehors, l’équivalent,
c’est le statut social, auquel les gens sont particulièrement
attachés. Ce qui m’a toujours beaucoup étonnée.
Il y a aussi quelque chose d’important, c’est le moment où
l’on prend conscience de ce régime en tant que spectacle. Qui,
dans la réalité, se traduit par le chaos, mettant à nu la
désorganisation et la non-optimisation de la majorité des
processus. Cela ne favorise pas le bon fonctionnement politique. Au
contraire, les gens sont de plus en plus désorientés, y compris
dans le temps et dans l’espace. Le citoyen, où qu’il se trouve,
ne sait pas où s’adresser pour régler tel ou tel problème. C’est
pour ça qu’il s’adresse au chef de la prison. Hors de prison, ce
chef s’appelle Poutine.
Nous sommes contre le chaos poutinien qui n’a de régime que le
nom. Nous donnons une image composite de ce système où, d’après
nous, presque toutes les institutions subissent une mutation, tout en
gardant leur apparence extérieure. De ce système qui détruit cette
société civile qui nous est si chère. Nos textes, s’ils
recourent au style direct, ne réalisent rien directement. Nous
considérons cela comme une forme artistique. Mais la motivation,
elle, est identique. Notre motivation reste identique dans une
expression directe. Cette motivation est très bien exprimée par ces
mots de l’Evangile : « Car quiconque demande, reçoit; et qui
cherche, trouve ; et à celui qui frappe à la porte, on ouvrira. »
Et moi, et nous tous, nous croyons sincèrement qu’on nous ouvrira.
Aujourd’hui, hélas, on nous a enfermées. En prison.
C’est très curieux que les autorités, en réagissant à nos
actions, ne tiennent absolument pas compte de l’expérience
historique passée des manifestations d’hétérodoxie,
d’anticonformisme. “La simple honnêteté est perçue dans le
meilleur des cas comme de l’héroïsme. Et dans le pire, comme un
trouble psychique », écrivait dans les années 70 le dissident
Boukovski. Il ne s’est pas écoulé beaucoup de temps et pourtant
tout le monde fait comme si la Grande Terreur n’avait jamais
existé, ni les tentatives de s’y opposer. Je considère que nous
sommes accusées par des gens sans mémoire. Nombre d’entre eux
disaient : « Il est possédé du démon, et Il a perdu le sens;
pourquoi l’écoutez-vous? » Ces paroles, ce sont les juifs qui ont
accusé Jésus Christ de blasphème qui les ont prononcées. Ils
disaient : « Nous vous lapidons pour un blasphème » (Jean 10.33).
Il est remarquable que c’est précisément ce verset auquel fait
référence l’église orthodoxe russe pour exprimer son avis sur le
blasphème. Cet avis est dûment certifié sur un document versé à
notre dossier criminel. En émettant cet avis, l’église orthodoxe
russe se réfère à l’Evangile comme à une vérité religieuse
immuable. L’Evangile n’est plus considéré comme un livre
révélé, ce qu’il fut pourtant dès l’origine. L’Evangile est
considéré comme un bloc de citations qu’on peut tirer et fourrer
où bon vous semble. Dans n’importe quel document et à toute fin
utile. Et l’église orthodoxe russe ne tient même pas compte du
contexte dans lequel est employé le mot « blasphème ». En
l’occurrence, il était appliqué à Jésus Christ.
Je considère que la vérité religieuse ne doit pas rester
immobile. Qu’il est indispensable de saisir les voies immanentes
pour l’évolution de l’esprit. Que les expériences de l’homme,
ses dédoublements, ses fissurations doivent être pris en compte.
Qu’il faut avoir vécu toutes ces choses pour se construire. Que
c’est uniquement après avoir vécu tout cela que l’homme peut
atteindre quelque chose et continuer à avancer. Que la vérité
religieuse est un processus, et non un résultat définitif qu’on
peut fourrer où bon vous semble. Et toutes ces choses dont j’ai
parlé, ces processus, sont pensés par l’art et la philosophie. Y
compris par l’art contemporain.
Une situation artistique peut, et se doit selon moi, comporter un
conflit intérieur. Et je suis particulièrement irritée par toute
cette « soi-disance » qui émaille les paroles de l’accusation
lorsqu’elle mentionne l’art contemporain.
Je tiens à remarquer que les mêmes termes ont été employés
lors du procès du poète Brodsky. Ses vers étaient désignés comme
des « soi-disant » vers, mais les témoins ne les avaient pas lus.
Comme une partie des témoins de notre procès, qui n’étaient pas
présents lors de notre action, mais qui ont regardé le clip sur
Internet. Il est probable que nos excuses soient également
présentées par l’esprit généralisateur de l’accusation comme
« soi-disant ». C’est une insulte. C’est un préjudice moral.
C’est un traumatisme. Parce que nos excuses étaient sincères.
Vous n’imaginez pas à quel point je regrette que tant de paroles
aient été prononcées et que vous n’ayez toujours rien compris.
Ou alors vous rusez, quand vous dites que nos excuses n’étaient
pas sincères. Je ne comprends pas ce que vous voudriez encore
entendre. Pour moi, c’est ce procès qui est un soi-disant procès.
Et je n’ai pas peur de vous. Je n’ai pas peur du mensonge, je
n’ai pas peur de la fiction, je n’ai pas peur de cette
mystification mal fagotée, je n’ai pas peur du verdict de ce
soi-disant tribunal. Parce que vous ne pouvez me priver que d’une
soi-disant liberté. C’est la seule qui existe sur le territoire de
la Fédération de Russie. Ma liberté intérieure, personne ne
pourra me l’enlever.
Elle vit dans le verbe, elle continuera à vivre quand elle
parlera grâce aux milliers de gens qui l’écouteront. Cette
liberté continue dans chaque personne qui n’est pas indifférente
et qui nous entendent dans ce pays. Dans tous ceux qui ont trouvé en
eux les éclats de ces processus, comme autrefois Franz Kafka et Guy
Debord. Je crois, que c’est justement l’honnêteté et la
puissance de la parole, et la soif de vérité qui nous rendront tous
un peu plus libres. Cela, nous le verrons.
Maria Alekhina, 8 août 2012,
traduction Helmut Brent